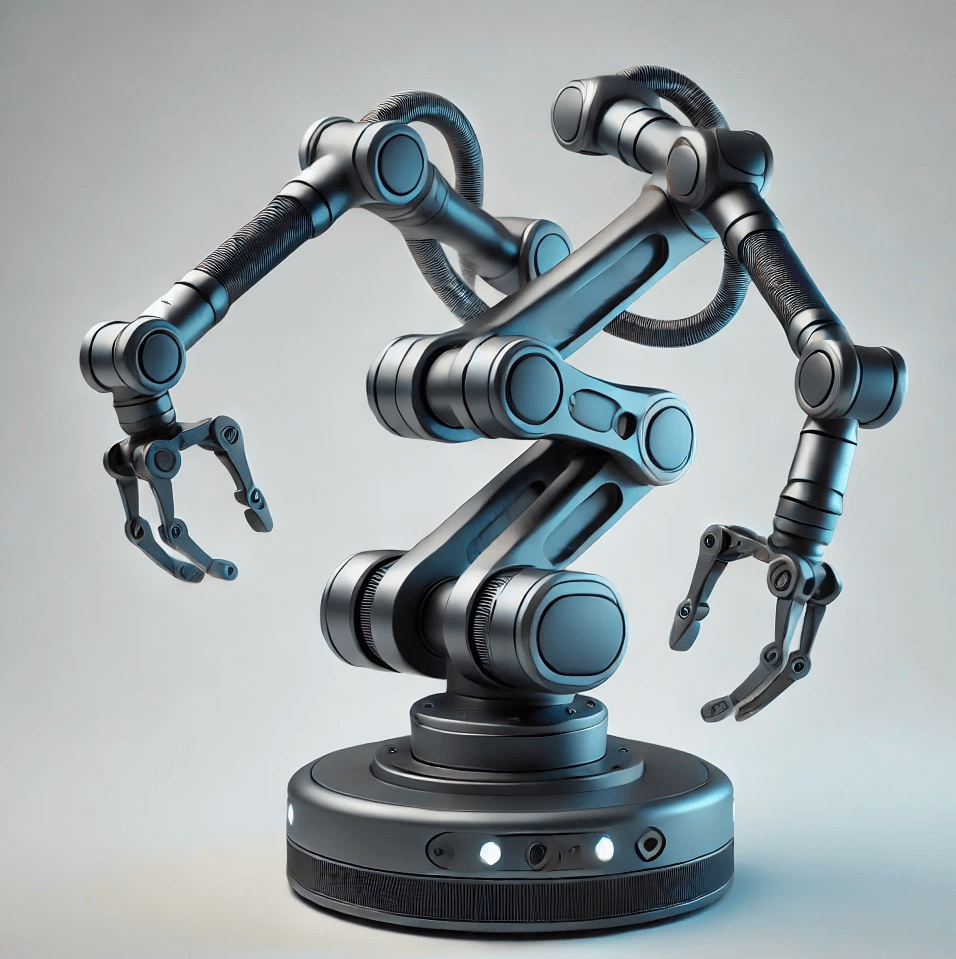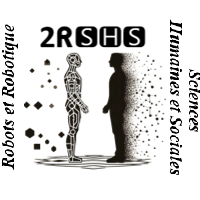« Saisir le « ça ne marche pas ! ». Où créer une expérimentation pluridisciplinaire pour « capter » le hasard »

16 mai 2025

Université Gustave Eiffel Cité Descartes
Campus de Marne-la-Vallée Bois de l’Étang
Aile C 5 Rue Galilée
77454 Champs-sur-Marne


Retour sur l’intervention « Saisir le « ça ne marche pas ! ». Où créer une expérimentation pluridisciplinaire pour « capter » le hasard » à la journée d’étude « Place(s) au(x) hasard(s) ! S’adapter et s’ouvrir à l’imprévu : Quand la sérendipité rencontre les SHS » au Laboratoire analyse comparée des pouvoirs de l’Université Gustave Eiffel.
David Gamet et Céline Rosselin-Bareille, tous deux anthropologues et membres du projet ciblé AS2 Mouvement en interaction physique et socialement adapté, ont présenté des réflexions sur leur cas d’étude « Saisir le « ça ne marche pas ! ». Où créer une expérimentation pluridisciplinaire pour « capter » le hasard » suivies de questions et d’échanges.
La thématique de la journée reposait sur l’utilisation de la sérendipité dans le processus de recherche en sciences humaines et sociales. Comment et pourquoi adapter nos méthodes de recherche, nos approches du terrain en s’adaptant à l’imprévu. Quelle est donc, finalement, la place du hasard dans nos méthodologies de recherche respective ?
Les objectifs de la journée étaient de réunir des chercheurs et chercheuses d’horizons divers (sciences de la gestion, géographes, historiens, anthropologues, sciences de l’information et de la communication) pour réfléchir et échanger autour de la notion de sérendipité selon trois axes : s’adapter à l’imprévu, provoquer le hasard ou comment le hasard s’invite dans nos terrains de recherches, et comment lui faire place et l’intégrer. Une table ronde en clôture sur « le hasard intégré », consistait en un échange théorique entre le sociologue Ludovic Joxe et les différentes définitions du hasard, Sylvie Catellin, maîtresse de conférence en science de l’information et de la communication, retraçant la naissance et les évolutions du concept de sérendipité et Vincent Lagarde, maître de conférence en gestion valorisant le concept dans la recherche en économie « non-orthodoxe ».
David Gamet et Céline Rosselin-Bareille sont intervenus dans le cadre du premier axe, consacré au hasard subi et à l’adaptation à l’imprévu. Ils y ont présenté des travaux s’appuyant sur la notion de hasard, en mettant en œuvre des dispositifs méthodologiques visant à le saisir et à l’intégrer pleinement dans la démarche de recherche.
Au fil de leurs échanges avec des roboticiens, leur méthodologie a considérablement évolué, allant jusqu’à inclure la notion d’expérimentation — une approche encore peu courante en anthropologie. En s’efforçant de capter les multiples petits imprévus survenant au cours de leur recherche, ils y trouvent, en tant qu’anthropologues, une source riche de sens. Ces mêmes imprévus sont cependant souvent perçus par leurs collègues roboticiens comme de simples « effets démo ».
Ces imprévus, difficiles à saisir et à prévoir, qui plus est dans une méthodologie d’anthropologie visuelle et filmique, les ont amené à un processus d’expérimentation (filmé) avec un danseur et des robots, choisis et mis en place par l’équipe RoBioSS de Pprime.
Leur intervention au cours de cette journée leur a ainsi offert l’occasion d’expliciter les choix ayant guidé la construction de leur méthodologie, laquelle repose également sur les notions de sérendipité et de maîtrise de l’imprévu. Cette approche vise à appréhender le plus efficacement possible leur objet de recherche : les formes d’engagement corporel dans l’interaction entre l’humain et le robot.
Autres Séminaire